Théorie moléculaire cinétique des gaz
 Share
Share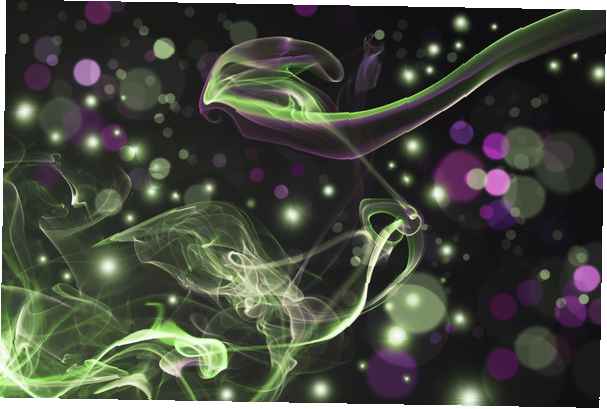
La théorie cinétique des gaz est un modèle scientifique qui explique le comportement physique d'un gaz comme le mouvement des particules moléculaires qui le composent. Dans ce modèle, les particules submicroscopiques (atomes ou molécules) qui composent le gaz se déplacent continuellement dans un mouvement aléatoire, entrant constamment en collision non seulement entre elles mais aussi avec les côtés de tout récipient dans lequel se trouve le gaz. C'est ce mouvement qui se traduit par des propriétés physiques du gaz telles que la chaleur et la pression.
La théorie cinétique des gaz est également appelée théorie cinétique, ou la modèle cinétique, ou la modèle cinétique-moléculaire. Il peut également, à bien des égards, être appliqué aux fluides ainsi qu'aux gaz. (L'exemple du mouvement brownien, discuté ci-dessous, applique la théorie cinétique aux fluides.)
Histoire de la théorie cinétique
Le philosophe grec Lucretius était un partisan d'une première forme d'atomisme, bien que celle-ci ait été largement rejetée pendant plusieurs siècles au profit d'un modèle physique de gaz construit sur le travail non atomique d'Aristote. Sans une théorie de la matière sous forme de minuscules particules, la théorie cinétique ne s'est pas développée dans ce cadre aristotléen.
Le travail de Daniel Bernoulli a présenté la théorie cinétique à un public européen, avec sa publication de 1738 de Hydrodynamica. À l'époque, même des principes comme la conservation de l'énergie n'avaient pas été établis, et donc beaucoup de ses approches n'ont pas été largement adoptées. Au cours du siècle suivant, la théorie cinétique est devenue plus largement adoptée par les scientifiques, dans le cadre d'une tendance croissante vers des scientifiques adoptant la vision moderne de la matière comme composée d'atomes.
L'une des lynchpins confirmant expérimentalement la théorie cinétique, et l'atomisme est général, était liée au mouvement brownien. Il s'agit du mouvement d'une minuscule particule en suspension dans un liquide qui, au microscope, semble se déplacer de façon aléatoire. Dans un article acclamé de 1905, Albert Einstein a expliqué le mouvement brownien en termes de collisions aléatoires avec les particules qui composaient le liquide. Cet article était le résultat du travail de thèse de doctorat d'Einstein, où il a créé une formule de diffusion en appliquant des méthodes statistiques au problème. Un résultat similaire a été réalisé indépendamment par le physicien polonais Marian Smoluchowski, qui a publié ses travaux en 1906. Ensemble, ces applications de la théorie cinétique ont largement contribué à soutenir l'idée que les liquides et les gaz (et, probablement, aussi les solides) sont composés de minuscules particules.
Hypothèses de la théorie moléculaire cinétique
La théorie cinétique implique un certain nombre d'hypothèses qui visent à pouvoir parler d'un gaz idéal.
- Les molécules sont traitées comme des particules ponctuelles. Plus précisément, cela implique que leur taille est extrêmement petite par rapport à la distance moyenne entre les particules.
- Le nombre de molécules (N) est très important, dans la mesure où le suivi des comportements des particules individuelles n'est pas possible. Au lieu de cela, des méthodes statistiques sont appliquées pour analyser le comportement du système dans son ensemble.
- Chaque molécule est traitée comme identique à toute autre molécule. Ils sont interchangeables par leurs différentes propriétés. Cela aide à nouveau à soutenir l'idée que les particules individuelles n'ont pas besoin d'être suivies et que les méthodes statistiques de la théorie sont suffisantes pour arriver à des conclusions et des prédictions.
- Les molécules sont en mouvement constant et aléatoire. Ils obéissent aux lois du mouvement de Newton.
- Les collisions entre les particules, et entre les particules et les parois d'un récipient pour le gaz, sont des collisions parfaitement élastiques.
- Les parois des conteneurs de gaz sont traitées comme parfaitement rigides, ne bougent pas et sont infiniment massives (par rapport aux particules).
Le résultat de ces hypothèses est que vous avez un gaz dans un conteneur qui se déplace de façon aléatoire dans le conteneur. Lorsque des particules de gaz entrent en collision avec le côté du conteneur, elles rebondissent sur le côté du conteneur dans une collision parfaitement élastique, ce qui signifie que si elles frappent à un angle de 30 degrés, elles rebondiront à 30 degrés angle. La composante de leur vitesse perpendiculaire au côté du conteneur change de direction mais conserve la même ampleur.
La loi du gaz idéal
La théorie cinétique des gaz est importante, dans la mesure où l'ensemble des hypothèses ci-dessus nous amène à dériver la loi des gaz parfaits, ou l'équation des gaz parfaits, qui relie la pression (p), le volume (V) et la température (T), en termes de constante de Boltzmann (k) et le nombre de molécules (N). L'équation du gaz idéal qui en résulte est:
pV = NkT
